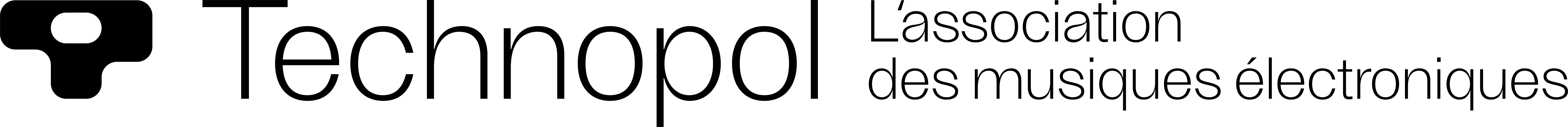Un glitch queer dans la matrice : Girls Don’t Cry revient à Toulouse du 5 au 7 décembre
Le Girls Don’t Cry Festival revient à Toulouse pour sa cinquième édition, du 5 au 7 décembre, entre La Cabane et le Centre Culturel Bonnefoy. Porté par La Petite, association culturelle féministe basée à Toulouse, ce rendez-vous est un espaces-temps queer et inclusif, où la fête devient un acte politique autant qu’un moment de partage. Né du média du même nom, Girls Don’t Cry concrétise les valeurs qui l’animent en ligne : donner de la visibilité aux artistes minorisé·es de genre, repenser les conditions d’accueil du public et réinventer nos manières de vivre la nuit. La fête s’envisage ici comme un espace d’émancipation collective, un laboratoire où les corps, les sons et les idées s’assemblent pour inventer d’autres possibles.
Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous présenter La Petite ?
La Petite est une association culturelle féministe basée à Toulouse, active depuis plus de 20 ans. Nous œuvrons pour l’égalité et contre les violences discriminatoires dans le secteur culturel. Nos actions se déclinent autour de trois axes principaux : la formation, la production d’événements et l’accompagnement des carrières des personnes sexisées dans le secteur culturel.
Nous intervenons notamment sur les questions de prévention des violences sexistes et sexuelles (VHSS), de représentations dans les programmations artistiques et de transformation des pratiques professionnelles dans la culture.
Quels sont les principaux enjeux que vous avez identifié sur la scène aujourd’hui ? Comment y répondez-vous à travers votre champ d’actions ?
Les scènes culturelles, notamment festives et musicales, restent encore très homogènes dans leurs programmations — avec une forte surreprésentation d’hommes blancs cisgenres — et peinent à devenir des espaces réellement inclusifs.
Par ailleurs, les milieux festifs peuvent être des lieux de violences : la dernière étude de Consentis (2025), a révélé que plus de 80% des femmes et minorités de genre y ont déjà subi des violences sexuelles.
Face à ces constats, nous cherchons à créer des espaces à la fois artistiquement pointus et profondément joyeux, où chacun·e puisse se sentir accueilli·e, respecté·e et en sécurité. Notre démarche est à la fois politique et esthétique : faire découvrir des artistes qu’on entend peu, tout en transformant les conditions de réception du public.
Girls Don’t Cry est à la fois un média et un festival. Pourquoi avoir choisi d’étendre le projet au format événementiel ? En quoi ce festival s’inscrit-il dans la continuité du travail mené avec le média ? Quels espaces cela permet-il de créer ?
Girls Don’t Cry est né comme un média en ligne, et une communauté engagée s’est très vite formée autour du projet. L’envie de se rencontrer “en vrai” est donc venue rapidement.
Le festival nous permet de concrétiser cette communauté : voir les gens, partager des émotions fortes ensemble, créer des souvenirs collectifs… Ce sont les moments qui donnent le plus de sens à ce qu’on fait.
Le média vit principalement sur les réseaux sociaux, et s’ils nous ont permis de toucher un large public, ils ont aussi leurs limites. Rien ne remplace l’expérience sensible, euphorisante, d’un concert ou d’un festival partagé. C’est dans ces espaces-temps que nos engagements prennent pleinement corps.
Voir cette publication sur Instagram
Vous travaillez avec le collectif Main Forte et des bénévoles qui sont formé·es à la prévention des VHSS. Comment ces dispositifs changent-ils la manière de vivre la nuit selon vous ?
Ces dispositifs permettent une prise en compte réelle des violences discriminatoires dans les milieux festifs. Ils transforment ces espaces en lieux de ressource, de soutien, voire de refuge pour les personnes concernées — et non plus seulement en lieux de risques.
C’est impressionnant de voir à quel point ces pratiques se sont diffusées en quelques années. On s’habitue à leur présence, et c’est tant mieux : elles nous permettent, à nous comme au public, de vivre la nuit plus sereinement, car on sait qu’une équipe formée est là pour intervenir avec bienveillance et efficacité.
Le festival est également co-construit avec des bénévoles. Qu’est-ce que cette dimension collective apporte à votre projet ?
C’est un aspect essentiel de notre démarche : créer un festival par et pour les publics. L’implication des bénévoles, au-delà du soutien logistique, enrichit le projet de mille façons.
Certaines idées fortes sont nées de leurs propositions, de leurs vécus ou de leurs expertises. C’est ce qui donne au festival sa forme mouvante, vivante, et ancrée dans des réalités multiples. Par exemple, cette année je n’aurais pas pensé à inviter une chorale à se produire au festival, et depuis 5 ans j’ai découvert énormément d’artistes grâce aux bénévoles qui se mobilisent pendant 6 mois à nos côtés.
Comment vos engagements féministes, queer et activistes se traduisent-ils concrètement dans vos choix artistiques, vos modes d’organisation et vos pratiques de travail ?
Nos choix artistiques reflètent directement nos engagements : nous programmons exclusivement des artistes femmes et queer, avec au minimum 50% de personnes racisées.
Mais cela va au-delà de la programmation. Nous expérimentons aussi d’autres manières de travailler : même si notre structure reste hiérarchisée, avec un CA et une direction, nous mettons en place des groupes de travail, des espaces de co-décision et de réflexion collective, pour faire émerger d’autres modes d’organisation, plus horizontaux, plus à l’écoute.
📆 du 5 au 7 décembre
🎫 Billetterie sur ce lien