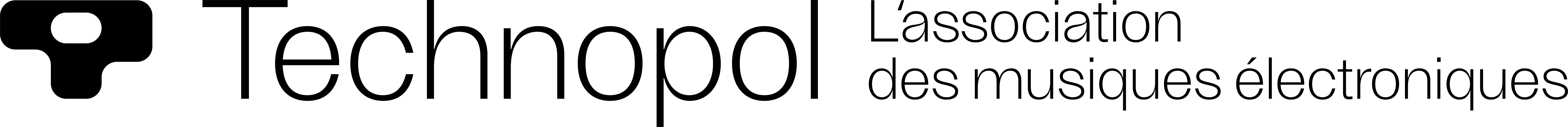Enter the Club : le Sucre à Lyon
Entrez dans le club et venez fouler les plus beaux dancefloors européens. Technopol est parti à la rencontre des gérant·e·s, des programmateur·rice·s, des chargé·e·s de communication,… qui ne cessent de faire vivre nos chères et tendres musiques électroniques. Une ode à leur passion, dans ces lieux de culture, de rencontre et de création : iels se battent pour continuer à nous accueillir dans toujours plus de folies, d’inclusivités et surtout de voyages musicaux. Comment ont-ils évolué depuis leur soirée originelle ? Quelle est la particularité de leur programmation ? Qui sont les fêtard·e·s qui font vivre leurs murs ? Et comment nous feront-ils danser demain ? Iels y répondent dans Enter The Club.
 Nuits sonores 2022 ©Kevin Buy
Nuits sonores 2022 ©Kevin Buy
Technopol : Comment le Sucre s’est-il installé dans ce lieu particulier, le toit de la Sucrière, ancienne usine de sucre du quartier industriel de la Confluence ?
Pierre-Marie Oullion : La Sucrière a été historiquement le premier lieu investi par Arty Farty, avant même qu’on organise Nuits Sonores. J’ai commencé à travailler chez Arty Farty avant la création du festival, avec Fred Joly, Violaine Didier et Cécile Chaffard. Iels avaient créé un événement au croisement entre art contemporain et musique électronique, dans l’air du temps du début des années 2000, où toute une partie de la culture électronique venait non pas du phénomène techno et house mais de la musique et de l’art contemporain, avec Pierre Henry, John Cage… Arty Farty a créé un événement défricheur de cette tendance qui commençait à s’épanouir dans les friches des grandes villes, en parallèle des raves. À l’époque, il n’y avait rien à la Confluence, ce n’étaient que des friches industrielles. Quand Nuits Sonores est arrivé, c’était le rassemblement d’Arty Farty et de personnalités comme Vincent Carry, Patrice Mourre, José Lagarellos, Agoria : le croisement entre l’art contemporain et la culture rave.
La Sucrière appartenait aux Voies Navigables de France, qui avait anticipé le futur projet Confluence et déjà acheté le foncier. Ce fut ensuite un délire de promoteurs immobiliers mêlé à une forte volonté politique… Une Société d’Economie Mixte (SEM) s’est créée entre VNF et la Ville de Lyon pour gérer le projet Confluence avec les grands promoteurs. La Ville se demandait quoi faire de la Sucrière, elle avait déjà la volonté d’en faire un lieu culturel. Avec le Musée d’Art Contemporain et Thierry Téodori, directeur de la Halle Tony Garnier, on a proposé un premier projet atypique, avec des expositions sur un étage, la réhabilitation de la salle du bas pour y faire des concerts, et Vincent a imaginé faire un club sur le toit. Le projet traîne… et on apprend quelques années plus tard que GL Events (grande entreprise d’événementiel d’origine lyonnaise, ndlr) va assurer la gestion du lieu avec un promoteur, avec l’installation d’un club sur le toit !
À force de pushing, grâce aussi à notre histoire, on espère à minima remporter la gestion du lieu. On sait depuis des années qu’il nous faut un lieu pérenne. Du fait que nous sommes partenaires de GL Events sur Nuits Sonores et qu’on était à l’origine de l’idée d’un club sur le toit, on obtient de GL de pouvoir concourir à l’appel d’offres. On rédige un beau dossier et on remporte l’offre haut la main : les deux autres n’avaient pas de projet culturel, et la Ville avait imposé à GL Events de garder un droit de regard sur ce qu’allait devenir le seul bâtiment patrimonial industriel conservé dans le quartier.
GL Events savait aussi qu’économiquement, nous serions capables de répondre à leurs attentes démesurées. C’est un lieu que nous louons extrêmement cher. GL Events a livré l’ossature et la dalle, nous avons réalisé tous les travaux, l’aménagement, le système son évidemment, sur mesure. On a construit un dossier avec un budget béton, en prévoyant de lever des fonds. On a ouvert à l’actionnariat, c’est pour ça que Laurent Garnier a d’ailleurs investi des parts, j’ai moi aussi fait un emprunt pour investir.

Rooftop de la Sucrière ©Le Sucre
Technopol : Vous avez proposé un modèle totalement indépendant, sans subvention ?
BP : Oui, on a toujours fonctionné sans subvention. On a touché notre première subvention en 2021, pendant la fermeture, car on a obtenu une aide du CNM pour accueillir des résidences d’artistes.
PM : En tant qu’entreprise privée, on n’a pas vocation à fonctionner avec des subventions. On a créé le club sur un modèle économiquement porteur : on privatise la semaine, et on ouvre au public le week-end. Ça a cartonné d’emblée. Cédric, qui gérait la Plateforme où on organisait 80% de nos Échos Sonores, est devenu le directeur d’exploitation.
Technopol : Quelles ont été les grandes périodes de la vie du Sucre, les moments clés ?
BP : L’installation des résidences.
PM : On travaillait sur la scène locale depuis déjà dix ans, c’était important pour nous d’installer des résidences dès le début : avec Kosme, Sacha Mambo… Je cherchais des collectifs qui nous apportaient ce qu’on n’avait pas encore, avec un discours fort. J’ai rencontré par hasard Mickaël Tramoy aka Chantal la nuit et il m’a parlé de Garçon Sauvage, des soirées qu’il organisait au Sonic ; j’aimais bien le Sonic à l’époque, c’était un lieu underground et noise qui s’ouvrait aux soirées, italo, dark disco, et queer… Je propose alors à Mickael d’organiser une Garçon Sauvage au Sucre. La première soirée était complètement dingue. Ça a beaucoup fait changer le club, car ça a amené cette communauté queer à fréquenter nos autres événements.
BP : On voulait travailler avec le plus de communautés possibles. Nous, on connaît un certain type de soirées, celles où on a l’habitude d’aller, mais beaucoup de gens font la fête ailleurs, autrement, dans des lieux où on ne se croise pas. Le Sucre devait devenir une maison pour ces cultures de nuit qui s’expriment sur le territoire. Ensuite, tu es allé chercher Black Atlantic Club…
PM : Black Atlantic Club, c’est un autre projet monté de toute pièce, à partir d’une rencontre : celle avec Metiola, un ami de collège qui travaillait sur les scènes africaines et sud-américaines ; et avec James Stewart, qui avait fait une thèse sur le Black Atlantic. Je partais alors du constat que le Sucre avait un problème majeur : le manque de mixité. J’ai fait quelques tentatives, comme avec Place du Pont Productions : le CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes) a retrouvé 40 ans de musique de la Guillotière en cassettes, dans des caves, qui étaient parties au Maghreb et que personne n’avait jamais écoutées… On a tenté une soirée avec un des gars qui avaient découvert ces cassettes et qui était DJ : une soirée Raï au Sucre. Certains nous ont dit : qu’est-ce que vous faites, rendez-nous notre club ! Et on avait envie de leur répondre : ce n’est pas votre club.
BP : On a expérimenté des choses, et tenté de créer des habitudes. Le raï par exemple, ce n’est pas la musique de ceux qui viennent écouter de la techno, c’est justement la musique d’une communauté qui ne vient pas au Sucre, et c’est ce qui nous intéressait. On a commencé à explorer ces musiques qui se sont déplacées d’Afrique en Amérique du Sud, qui sont une des influences majeures de la techno et de la musique dansante en général ; on a amené des DJs qui jouaient cette musique-là, Motor City Drum Ensemble, Laurent Garnier, Mehmet Aslan aussi faisait partie du projet… On a voulu ramener du live dans le club. Fela Kuti, quand il jouait dans les clubs de Kinshasa, il ne jouait pas de 20h à 23h : ça durait jusqu’à 6h du matin. Alors qu’en France, on ne pouvait écouter ces musiciens là que dans des SMAC, à 20h30. C’était justement intéressant d’inviter ces groupes à jouer au Sucre dans un contexte plus proche de leur musique d’origine. On arrivait aussi à un moment où la musique électronique allait avoir 30 ans : est-ce qu’on ne tournait pas un peu en boucle ? Où se trouvaient les nouvelles énergies ? Force est de constater que c’est plutôt dans les pays du Sud qu’on trouvait du renouveau, une expression différente, des polyrythmies…
PM : Il y a une dialectique entre le Sucre et les Nuits Sonores. Avec le club, on peut travailler à l’année avec le public local, faire de la médiation, maturer des projets. À l’inverse, le festival permet de mettre l’accent sur un groupe ou un courant à un moment précis : si ça marche, on pourra continuer à y travailler avec le Sucre.
BP : Un bon acte à Nuits Sonores peut devenir une tête d’affiche immédiatement après. Et notre laboratoire, c’est le Sucre.
PM : Les dimanches sont une autre étape importante. On se demandait pourquoi on n’arrivait pas à recréer à Lyon l’atmosphère berlinoise, qui nous inspirait beaucoup, et on a vu que le dimanche là-bas était une case importante. José Lagarellos, le programmateur des Nuits Sonores, a voulu alors proposer des gros actes techno ou house le dimanche : les We Are Reality. On s’est aperçu très vite que c’était un jour difficile à travailler.
BP : Le public à l’époque n’avait pas du tout la culture de sortir en journée le dimanche.
PM : Sans tête d’affiche, c’était compliqué. Alors qu’aujourd’hui, le meilleur public du Sucre pour la programmation techno « occidentale » c’est le dimanche, et c’est là qu’on met les têtes d’affiche : c’est là qu’on a décidé que la techno doit être.
BP : Le vendredi, on a un public plus étudiant, ou fatigué de sa semaine…
PM : On peut vite avoir des situations dangereuses.
BP : Alors que le dimanche après-midi, les gens arrivent sobres ou presque, avec une énergie de dingue.
PM : Un public difficile, c’est compliqué à gérer pour les équipes d’exploitation. On est aussi vigilants à adapter notre programmation à cette donnée car nous travaillons principalement au bureau, mais le directeur d’exploitation, Cédric Dujardin, doit gérer ce public. Au fur et à mesure des années, Cédric a vraiment commencé à incarner le lieu, son compte Instagram @directeurjouretnuit est populaire, il montre aussi le côté backstage… Il gère, il fait attention à tout le monde, il est extrêmement curieux de tout, il apporte une attitude positive qui se ressent dans le club, il s’approprie le lieu et surtout la relation entre le lieu et le public.
BP : On s’appuie énormément sur son sentiment du public pour construire notre programmation. Pour revenir au dimanche, il faut se remettre dans le contexte de l’ouverture : Lyon reste, entre guillemets car je déteste l’expression, une ville « de province » et on était en concurrence avec les capitales européennes : Berlin, Londres, Bruxelles…
PM : Sauf Paris.
BP : D’ailleurs je n’ai pas cité Paris ! Au Sucre on n’a pas le même public, pas les mêmes moyens financiers à déployer, et donc finalement pour réussir à programmer ces têtes d’affiche, on réalise que c’est plus facile le dimanche. D’autant plus que chez les DJs il n’y avait aucune conscience écologique : si je fais Stockholm, Cracovie et Barcelone en un week-end, au contraire, c’est mieux pour l’image…
PM : La bascule sur le dimanche s’opère grâce à la gratuité, qu’on propose avant 19h : c’est ce qui a fait marcher cette nouvelle proposition.
BP : Ceux qui veulent vraiment voir l’artiste achètent leur place avant ; et si on n’a pas fait complet, on a en moyenne 300 personnes qui tentent le coup pour entrer gratuitement avant 19h, et souvent iels ont leur teuf gratuite ! C’est ce public là qu’on voulait, de vrai·e·s clubbeur·euses. On voulait absolument que le Sucre ne soit pas un club d’after. On a de gros enjeux de politique culturelle, avec l’écosystème Nuits Sonores et European Lab, et on ne veut pas faire n’importe quoi avec le Sucre ; de toute façon, ce n’est pas dans la culture des équipes et personne ne s’y retrouverait. On voulait avant tout avoir un public qui vient pour danser. C’est une des problématiques de la club culture : quelle est la différence entre sortir pour se mettre la tête à l’envers, et sortir pour écouter de la musique ? On a toujours choisi notre camp. On propose aussi le Mini Club, où on choisit volontairement de diviser la jauge par deux, et ce avant même le covid ! Peu de lieux sont prêts à dire : je vais volontairement vendre deux fois moins de tickets, pour le confort de mon public et pour la cohérence de ma programmation. Ça nous permet de proposer une programmation plus pointue, et on en a besoin pour le projet culturel qu’on défend.
PM : Pour conclure sur les grandes étapes de la vie du Sucre, la réponse est difficile car on a vraiment fait dix années de réglages, avec beaucoup de tentatives et de propositions différentes, comme le Roller disco, les Super Dimanches en famille, les tournois de ping-pong, les « Après le travail »… L’accident (en 2015, un jeune homme est tombé du rooftop, il a survécu mais est devenu tétraplégique, ndlr) nous a vraiment marqué dans la volonté de faire du Sucre un lieu mature, pas un espace de liberté temporaire où les gens font n’importe quoi, mais un espace de programmation où les gens s’épanouissent.
BP : C’est un espace de liberté au long cours, avec des règles communes pour se sentir libre et le plus safe possible.
PM : On fait ces réglages petit à petit, pour trouver un équilibre économique mais aussi artistique, ne pas faire de concessions dans notre programmation pour garder un maximum de liberté dans nos propositions : si on veut faire une soirée raï, on la fait ! Et si tu viens, tu écoutes, mais tu ne gueules pas : il fallait regarder la programmation.
BP : Et maintenant, quand les gens n’aiment pas la musique, ils partent, mais ils ne râlent plus comme au début.
 Le Sucre ©Gaetan Clément
Le Sucre ©Gaetan Clément
Technopol : Quelle est la relation du Sucre avec son public ? Comment ce public a-t-il évolué ?
PM : Notre credo de base c’était : pas de physio, le Sucre est ouvert à tout le monde. On voulait sortir de ces années de discrimination dans la club culture. Les seules personnes qui ne rentrent pas sont celles qui n’ont pas acheté un billet à temps, ou qui ne sont pas physiquement en état – mais ça, de toute façon, c’est interdit par la loi. La licence 4, c’est énormément de responsabilités : tout ce qui peut se passer jusqu’à 4h après avoir quitté le club, peut finir par être lié à la responsabilité du club. À un moment donné, on a donc mis en place une carte de membre pour le public. On voulait à la fois fidéliser le public, et pouvoir blacklister les personnes problématiques. On voulait aussi avoir un public intergénérationnel, et pouvoir cibler à qui on s’adressait ; maîtriser notre public, mais sans la physionomie discriminatoire. On a fini par l’abandonner car logistiquement, c’était ingérable. On l’a remplacé par des analyses de données de billetterie, en ciblant spécifiquement des catégories de public.
BP : Un autre élément fondamental du Sucre c’était : pas de carré VIP, pas de bouteille. Il y a encore des gens qui nous en demandent ! Ça faisait partie de nos fondamentaux : on n’est pas vraiment un club, on est plutôt un lieu de concert de nuit. On voulait justement effacer ces différences sociales, qui sont codifiées la journée. Si quelqu’un était en costard de banquier, on ne le verra pas le soir.
PM : Ces dix années de recherche ont amené une maturité qui nous permet aujourd’hui de lancer notre nouveau projet, avec plus d’implication territoriale dans la programmation, des artistes qui restent plus longtemps, s’impliquent dans la médiation, et avec un volet de formation.
BP : On veut être une maison qu’on partage. On n’aurait jamais fait toutes ces soirées sans la rencontre avec des collectifs comme Garçon Sauvage. Aujourd’hui, on travaille avec le collectif Jamais le mardi, sur des esthétiques dancehall, caribéennes et très pop, un collectif très suivi sur Lyon, et on n’avait jamais fait de soirées comme ça au Sucre.
PM : On ne loue jamais le lieu. On fait parfois des coproductions, mais on valide toujours la direction artistique. On a toujours été intransigeants, et c’est sûrement pour ça qu’on est encore là aujourd’hui. À contrario, on ouvre le lieu au maximum, en allant chercher des collectifs qui ne viendraient pas naturellement chez nous, et qui ne nous contactent pas.
BP : On produit tous les événements : on rémunère les artistes avec des cachets, et les collectifs n’ont pas la pression de remplir le lieu ou non, c’est plus confortable pour leur permettre de développer leur identité sereinement. On fait beaucoup d’accompagnement administratif, on aide les collectifs et les artistes à se professionnaliser, on explique régulièrement le fonctionnement de l’intermittence du spectacle, même à des DJs qui ont 25 ans de métier…
PM : On cherche aussi à se départir de nos codes : nous sommes des hommes cisgenres blancs, nous avons un prisme culturel dominant, et si nous ne faisons pas de concessions par rapport à cette identité dominante, ça ne peut pas fonctionner.
 Garçon Sauvage ©Le Sucre
Garçon Sauvage ©Le Sucre
Technopol : Est-ce que votre métier de programmateur a changé ?
PM : Un bon programmateur connaît nécessairement plusieurs phases. Un programmateur qui débute apporte une révolution générationnelle : il programme tout ce qu’il a envie de voir et d’écouter, en lien avec une population et une génération, il apporte de l’innovation. Quand je suis arrivé, j’ai apporté une vision plus hip-hop, je comprenais ce que représentaient Ed Banger et Myspace… On parle le même langage qu’une génération, on a les mêmes aspirations.
Au bout d’un moment, évidemment, l’écart se creuse et le métier change : on passe plus à de l’accompagnement et à du sourcing, c’est finalement plus proche d’une approche journalistique. Mes goûts personnels ont changé, je ne vais plus programmer systématiquement mes coups de cœur à moi, tout le monde s’en fout aujourd’hui ! C’est juste important d’en faire quelques-uns, de temps en temps, pour ne pas perdre la passion.
BP : Aujourd’hui, les clubs se parlent : la crise sanitaire aura apporté ça de bon ! Je me souviens que Flo, qui programmait l’Iboat à Bordeaux, nous avait appelé pour avoir des conseils sur le développement du dimanche. Si on peut faire gagner du temps à d’autres en leur transmettant notre expérience, tant mieux ! Plus il y aura de clubs qui ressemblent à ce que l’on fait ici, mieux ce sera. On parle beaucoup avec le Macadam sur des sujets communs ; on crée des codes communs, des attentes communes sur notre public ; ça diffuse cette culture commune, de Nantes à Lyon !
PM : Ce qui a fondamentalement changé avec le Sucre, c’est le travail dans le temps avec les artistes. Cette loyauté nous permet d’apporter de la régularité, de suivre un artiste dans ses hauts comme dans ses bas, et de sortir d’une logique capitaliste de programmation.
BP : Quand tu as commencé, il y avait beaucoup moins d’étapes dans la relation entre un programmateur et un artiste : tu écrivais à un artiste, et il te répondait. Aujourd’hui, le nombre d’étapes a beaucoup augmenté : tu parles avec un agent, qui parle avec un agent spécialisé sur tel territoire, qui parle à un manager… Un programmateur et un artiste parlent le même langage, alors que ces intermédiaires en parlent souvent un autre, ils défendent des intérêts économiques. Et le discours de base, artistique, qu’on a avec Daniel Avery, Kink, Laurent Garnier, Anetha… finit par se perdre. Le nouveau projet du Sucre permet justement de retrouver ça.
 Nuits Sonores ©Laurie Diaz
Nuits Sonores ©Laurie Diaz
Technopol : La parité et la formation sont des volets importants de votre nouveau projet. Comment avez-vous identifié ces priorités ?
PM : Concernant la parité, on avait l’envie, mais on n’avait pas forcément la méthode. On a tenté des trucs horribles : une soirée « Girl », annoncée comme ça… On ne l’a fait qu’une fois ! Mais on n’avait pas forcément la matière artistique pour proposer la parité. Typiquement, c’est une expérience que j’ai tentée en dehors du Sucre avec mon collectif. On n’arrivait pas à avoir de présence féminine sur tous nos line-ups, on était un gros collectif de 25 personnes, tout le monde ne mixait pas. On a proposé à des filles du collectif d’apprendre à mixer, pour jouer dans nos événements. Leur réaction m’a surpris : pas une seule seconde d’hésitation, pas de pression, on y va ! Alors on a décidé de le faire au Sucre, entre les deux confinements, quand on était fermés. On voulait donner des cours gratuits et en non-mixité. Au début on ne pouvait pas communiquer dessus, on ne voulait pas communiquer sur de la discrimination…
BP : Et il fallait déjà qu’on expérimente ce que l’on allait faire.
PM : On l’a fait en cercle restreint, puis ça s’est agrandit, on s’est rendu compte que ça créait une offre artistique, que ça permettait de créer des line-up plus paritaires. C’est devenu un axe du Sucre car on sait maintenant qu’avec de la formation en « discrimination choisie », ça permet de se rapprocher de la parité. On y est arrivé sur le Nuits Sonores hors-série de 2021. On faisait déjà la parité à Nuits Sonores dans A Day With… car c’était un programme phare, mais on n’y arrivait pas sur toute la programmation.
BP : Au niveau international, on y arrivait facilement ; au niveau national, c’était un peu plus compliqué ; mais localement, c’était vraiment là qu’on n’y arrivait pas, on devait avoir 4 filles qu’on faisait jouer régulièrement, pour 100 garçons qui nous écrivaient pour jouer ! Il suffisait en fait de les former, ça paraît évident, mais ça ne l’était pas…
Technopol : Quelle est la place de l’écologie dans votre nouveau projet ?
PM : La parité est liée aussi à la question de l’écologie car finalement plus d’artistes locaux, ça veut dire aussi moins de transports et de transferts, qui représentent un gros poste d’émission de carbone !
BP : 80% de nos résident·e·s sont français·e·s et viennent en train. Mais on est contents d’accueillir à nouveau des artistes internationaux·ales, pour ne pas s’enfermer dans un prisme franco-français et continuer cette démarche de désoccidentalisation.
PM : On a travaillé avec The Shift Project sur l’impact carbone de Nuits Sonores. On s’est donné comme objectif a minima de respecter les accords de Paris. Les deux principaux postes sont le transport des festivaliers, sur lequel on ne peut pas faire grand chose à part encourager les mobilités moins polluantes ; et la nourriture : on est donc passés en 100% végétarien, y compris pour les repas artistes.
BP : On a encore du chemin à faire, notamment sur la question du plastique. On aimerait avoir du verre consigné, mais il n’y a pas encore de fournisseur en France, contrairement à l’Allemagne par exemple… Il y a aussi une problématique économique. On a estimé la perte de chiffre d’affaires d’un arrêt de la vente de bouteilles d’eau à 50 000 euros pour le festival, sans compter l’investissement dans des fontaines… C’est typiquement sur ce genre de sujets qu’on a besoin d’accompagnement, y compris financier, par les pouvoirs publics.
Article écrit par Auriane Scache
Technopol à besoin de votre soutien !
Pour devenir adhérent·e·s à notre association et participer à nos actions de défense et de promotion des cultures électroniques 👉 Cliquez sur ce lien !
![]()